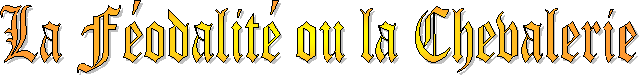

La
légende athurienne est composée d’un certain nombre de motifs folkloriques
hétérogènes organisés en un édifice plus ou moins cohérent. En fait, la figure
d’Arthur se situe au confluent de traditions et de cultures variées : mythologie
celtique, héritage antique, modèle féodal et tradition chrétienne.
Arthur,
symbole de la féodalité
Arthur, le « roi qui fait les chevaliers », comme le dit le Perceval de Chrétien de Troyes, est le garant de ce système où les individus poursuivent leur propre accomplissement, tout en restant prêts à répondre à la convocation du souverain lorsqu’il s’agit d’une guerre.
La cour est le centre de l’univers arthurien ; les
chevaliers reçoivent leur armes de la main d’Arthur lui-même.
Celui-ci, est dépeint à l’origine, comme un excellent
guerrier, qui mène ses armées à la victoire, en payant de sa personne en de
nombreuses occasions. Cependant, par la suite, Arthur cesse d’être un chevalier
actif pour devenir un symbole du pouvoir royale.

 Courtoisie et
« fin’amor »
Courtoisie et
« fin’amor »
A la différence de Charlemagne, Arthur n’est pas seulement un roi guerrier ; le monde chevaleresque dont il est l’expression la plus achevée et symbole est aussi un univers où règne la courtoisie, cette idéologie nouvelle importée de la France du Sud. Les règles de la courtoisie ne se distinguent guère des préceptes chrétiens : le chevalier doit mettre son épée au service de la veuve et de l’orphelin, il doit se comporter en toutes circonstances comme un homme honorable, en respectant les droit de chacun, et les faisant respecter si nécessaire. Mais l’accent est surtout mis en avant sur la conduite à tenir à l’égard des dames et des demoiselles. Flirter avec toutes les jeunes filles constitue déjà une attitude condamnable par l’église, les principes de la « fin’amor », c’est à dire de la passion courtoise « sérieuse », sont absolument scandaleux, puisque l’amour parfait est nécessairement adultère, et qu’au demeurant l’amant est censé être entièrement soumis au caprice de sa dame.
Le triangle
amoureux
A l’origine, le roi Arthur est marié, conformément à l’image classique du bon souverain. Comme on le verra plus loin, la reine Guenièvre est sans doute une adaptation de la figure mythique de la Souveraineté.
Mais dans l’Historia et dans le Brut, bien qu’elle ne donne pas d’héritier à Arthur, elle est considérée comme une bonne épouse, jusqu’au moment où elle trahit le roi en devenant la femme de l’usurpateur Mordred. Cependant, dans les textes romanesques, l’image de Guenièvre va changer. C’est à Chrétien de Troyes, que l’on doit l’invention du personnage de Lancelot, qui apparaît comme l’amant de la reine- et naturellement le meilleur chevalier du monde-. Cette passion adultère est cause d’ailleurs, qu’il ne peut réussir dans la quête du Graal, et provoque en définitive la fin du rêve arthurien. Mais une des lois chevaleresques est la défense des vertus chrétiennes : quelle que soit sa colère à l’égard de Guenièvre, Arthur la reprend à son côté lorsque l’Eglise l’exige sous peine d’excommunication.

Galchaut, le prince des Lointaines Iles, a renoncé à conquérir le royaume d’Arthur pour gagner l’amitié de Lancelot. Il découvre l’amour secret de ce dernier pour la reine et, par la plus généreuse manière, parvient à réunir le chevalier et son « amie ».
Au
confluent de la tradition chrétienne et de la légende celtique
C’est qu’Arthur, comme Charlemagne, est un roi chrétien, dont la tâche est de défendre la chrétienté. Mais le corpus arthurien appartient aussi à une tradition plus ancienne, celtique et païenne, qui rattache Arthur au panthéon des Dieux Celtes et lit les récits qui lui sont consacrés selon une interprétation mythique. A l’appui de cette théorie, on mentionne la présence d’un roi Arthur primitif dans certain textes irlandais et gallois qui témoignent en effet d’un état de la légende antérieur à ce qui a été conservé dans les textes littéraires. Ainsi, l’épée d’Arthur dans cette tradition est « Caledlwch », dont il n’est pas difficile de dériver la célèbre « Excalibur ». Le lien le plus net d’Arthur avec les mythes celtes est sans doute sa sœur, que la tradition connaît sous l’appellation quasi générique de la « fée Morgane ». Modèle de fée amante, elle est sans doute à l’origine une incarnation de la Grande Déesse-Mère, dont l’union incestueuse avec le roi, doit assurer la fertilité de la terre. Ceci explique son conflit avec Guenièvre, autre image de la Déesse en tant qu’elle incarne la Souveraineté, principe féminin auquel le roi doit s’unir charnellement pour acquérir le droit d’exercer le pouvoir.